Conseil
Élus locaux : un mandat pour agir
Parce que l'urgence environnementale est une préoccupation majeure de nos concitoyens et que le rôle de l’élu est déterminant pour la transition écologique, l’ADEME et l’Office français de la biodiversité partagent des conseils et des actions concrètes pour leur territoire. Des solutions éprouvées qui montrent qu’il est possible d’envisager une ville plus sobre et dynamique sur le plan social et économique.
Réseau Élus pour agir
Pour mieux décrypter la transition écologique et énergétique, mieux connaître les acteurs et les outils, et accéder aux meilleurs experts, rejoignez un réseau unique d’élus référents transition écologique et énergétique. L’adhésion au réseau est gratuite !

Idées et solutions pour la transition du territoire
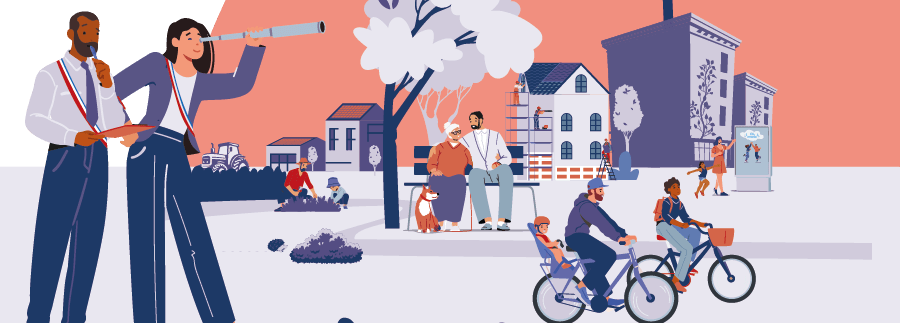
Parce que l'urgence environnementale est une préoccupation majeure de nos concitoyens et que le rôle de l’élu est déterminant pour la transition écologique, l’ADEME et l’Office français de la biodiversité partagent des conseils et des actions concrètes pour leur territoire. Des solutions qui ont déjà fait leurs preuves dans des collectivités de toutes tailles.


